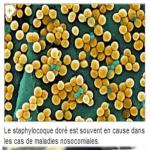Blog
Recettes Tisanes Produits Contacts
AfrikBio Côte d'Ivoire +22507744551
Afrikbio Gabon : +24177855621 ou +24166100337
Cameroun: +23795735357
Benin:+22961007412
-
Adénomyose qu'est ce que c'est ?
- Par narso10
- Le 07/10/2025
L’utérus, organe central de la reproduction féminine, est une structure complexe composée de plusieurs couches. Parmi elles, on distingue l’endomètre, qui tapisse la cavité utérine, et le myomètre, qui constitue la paroi musculaire de l’utérus . Normalement, ces deux tissus demeurent bien séparés. Cependant, dans certaines circonstances pathologiques, cette séparation s’efface. C’est précisément le cas de l’adénomyose, une affection gynécologique souvent méconnue mais pourtant fréquente chez les femmes en âge de procréer. Contacter nous ,
Ainsi, l’adénomyose se définit comme la présence anormale de tissu endométrial (semblable à celui de la muqueuse utérine) à l’intérieur du myomètre, c’est-à-dire au sein du muscle utérin lui-même. En d’autres termes, la muqueuse utérine s’infiltre là où elle ne devrait pas être, provoquant des réactions inflammatoires, des douleurs intenses et parfois des saignements abondants.
2. Mécanismes et causes de l’adénomyose
Bien que la cause exacte de l’adénomyose demeure encore sujette à débat, plusieurs mécanismes physiopathologiques ont été proposés.
D’une part, certains chercheurs évoquent une invasion directe du tissu endométrial dans le muscle utérin à la suite de microtraumatismes de la paroi utérine. Ces microtraumatismes peuvent résulter de grossesses multiples, de césariennes, de curetage, ou encore de fibromes utérins.
D’autre part, une autre théorie suggère une origine congénitale , c’est-à-dire que des cellules endométriales seraient piégées dans le myomètre dès la vie embryonnaire et se développeraient plus tard sous l’influence hormonale.Par ailleurs, il convient de souligner que l’adénomyose est fortement dépendante des hormones, notamment des œstrogènes. Ainsi, elle est rare avant la puberté et tend à régresser après la ménopause, période où la production d’œstrogènes diminue significativement.
3. Les symptômes caractéristiques
Dans bien des cas, l’adénomyose peut passer inaperçue pendant plusieurs années, car certaines femmes ne présentent aucun symptôme visible. Cependant, lorsque la maladie s’exprime, elle se manifeste de façon progressive et handicapante.
Les principaux symptômes incluent :Des règles anormalement abondantes (ménorragies), souvent prolongées et accompagnées de caillots.
Des douleurs pelviennes chroniques, parfois insupportables, qui précèdent et accompagnent les menstruations.
Une dysménorrhée (règles douloureuses) très marquée, résistante aux antalgiques habituels.
Des douleurs pendant les rapports sexuels (dyspareunie).
Une sensation de lourdeur pelvienne ou de gonflement de l’abdomen.
Une infertilité inexpliquée, car l’adénomyose perturbe parfois la nidation embryonnaire.
Ces symptômes, lorsqu’ils s’intensifient, peuvent considérablement altérer la qualité de vie de la femme, affectant tant sa vie personnelle que professionnelle.
4. Diagnostic médical
Grâce aux progrès de l’imagerie médicale, le diagnostic de l’adénomyose est aujourd’hui plus aisé.
L’échographie pelvienne transvaginale constitue le premier examen d’orientation, permettant d’observer un utérus globalement augmenté de volume, souvent d’aspect hétérogène.
Cependant, c’est surtout l’IRM pelvienne (Imagerie par Résonance Magnétique) qui confirme le diagnostic, car elle permet de visualiser précisément l’épaisseur du myomètre et les zones infiltrées par le tissu endométrial.Dans certains cas, le diagnostic définitif peut être posé après hystérectomie, c’est-à-dire l’ablation de l’utérus, lorsque l’examen histologique du tissu révèle la présence d’adénomyose.
Contacter nous ,
-
Hypertention artérielle et la vieillesse complications
- Par narso10
- Le 03/10/2025
De nos jours, il est indéniable que l’hypertension artérielle constitue l’une des maladies chroniques les plus répandues dans le monde. Or, avec l’avancée en âge, la probabilité de développer cette affection augmente considérablement. En effet, le vieillissement s’accompagne de modifications physiologiques qui rendent les artères moins souples et la régulation de la pression sanguine plus difficile. Dès lors, il est essentiel de comprendre non seulement pourquoi l’hypertension artérielle est particulièrement fréquente chez les personnes âgées, mais aussi .
Contacter nous pour une prise en charge et le suivi nécessaire.
Cliquer ici pour visiter notre boutique .Vieillesse et hypertension : une association presque inévitable
Tout d’abord, il convient de rappeler que la vieillesse s’accompagne d’une série de changements biologiques. D’une part, les parois artérielles perdent progressivement leur élasticité. Par conséquent, le sang circule sous une pression plus élevée, ce qui favorise l’hypertension. D’autre part, la fonction rénale tend à diminuer avec l’âge, réduisant ainsi la capacité de l’organisme à éliminer efficacement l’excès de sel et d’eau. En outre, la sédentarité, souvent observée chez les personnes âgées, accentue encore ce risque. Parallèlement, les habitudes alimentaires riches en graisses et en sel, ainsi que la prise de certains médicaments, peuvent contribuer à l’élévation de la pression artérielle.
Contacter nous pour une prise en charge et le suivi nécessaire.
Cliquer ici pour visiter notre boutique .Facteurs aggravants liés à l’âge
En plus de ces transformations naturelles, d’autres facteurs propres à la vieillesse viennent compliquer le tableau. Ainsi, la fragilité générale, la diminution de la masse musculaire, mais également la fréquence accrue de maladies chroniques comme le diabète ou l’hypercholestérolémie, constituent des éléments aggravants. De surcroît, les troubles du sommeil, souvent négligés, peuvent accentuer la tension artérielle. Enfin, il est important de souligner que les personnes âgées présentent fréquemment une moindre observance thérapeutique, soit en raison d’oubli, soit à cause des effets secondaires des traitements, ce qui accroît le risque de complications.
Les complications cardiovasculaires
Ensuite, lorsque l’hypertension artérielle persiste sans être correctement contrôlée, elle entraîne inévitablement des complications, surtout chez les personnes âgées. Tout d’abord, le cœur doit travailler davantage pour éjecter le sang, ce qui conduit progressivement à une hypertrophie ventriculaire gauche, puis à une insuffisance cardiaque. Par ailleurs, l’hypertension favorise l’athérosclérose, c’est-à-dire le dépôt de plaques de graisse dans les artères, augmentant ainsi le risque d’infarctus du myocarde. En outre, les artères cérébrales sont particulièrement vulnérables, ce qui explique pourquoi les AVC (accidents vasculaires cérébraux) sont beaucoup plus fréquents chez les personnes âgées hypertendues.
Les complications rénales hypertention artérielle
Hypertention artérielle entraîne dans ce contexte spécifique plusieurs d'autres maladies tel que le diabète , l'hémiplégie . Ainsi, à travers cet article, nous examinerons successivement la relation entre vieillissement et hypertension, les mécanismes en jeu, ainsi que les principales complications qui en découlent.
Parallèlement, les reins subissent eux aussi les effets délétères de l’hypertension. En effet, une pression artérielle élevée endommage progressivement les petits vaisseaux sanguins rénaux, réduisant ainsi leur capacité de filtration. À long terme, cela peut conduire à une insuffisance rénale chronique, pathologie particulièrement redoutable chez les personnes âgées, car elle limite fortement la qualité de vie et nécessite parfois une dialyse. De ce fait, la prévention et le suivi régulier de la fonction rénale s’avèrent indispensables.Les complications ophtalmologiques et neurologiques
D’autre part, il ne faut pas négliger les conséquences de l’hypertension sur la vue et le système nerveux. Ainsi, la rétinopathie hypertensive, caractérisée par des lésions au niveau de la rétine, peut mener à une baisse progressive de la vision, voire à la cécité. De plus, sur le plan neurologique, l’hypertension chronique est associée à une démence vasculaire, car elle altère la circulation sanguine cérébrale et favorise la détérioration cognitive. Par conséquent, l’hypertension artérielle ne se limite pas à un problème cardiovasculaire, mais touche aussi d’autres organes essentiels.
-
La lumbago définition, causes, symptômes et traitements
- Par narso10
- Le 23/09/2025
La lombalgie, également connue sous le terme de lumbago ou plus simplement de douleur lombaire, constitue l’un des motifs de consultation médicale les plus fréquents dans le monde. En effet, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 80 % des individus connaîtront au moins un épisode de douleur lombaire au cours de leur vie. Or, cette affection, bien qu’elle soit souvent bénigne et transitoire, peut dans certains cas devenir chronique et altérer considérablement la qualité de vie. Comment peut t'on soigner ce mal naturellement ?
Ecrivez nous directement par whatsapp pour béneficier de nos suivis par les plantes .Définition de la lombalgie
La lombalgie désigne toute douleur localisée dans la région inférieure du dos, c’est-à-dire au niveau des vertèbres lombaires. Elle peut être aiguë, lorsqu’elle dure moins de six semaines, ou chronique, lorsqu’elle persiste au-delà de trois mois. De plus, il convient de souligner qu’elle peut être spécifique, lorsqu’une cause précise est identifiée (hernie discale, fracture, infection…), ou non spécifique, lorsqu’aucune cause organique claire n’est retrouvée.
Les causes principales
Il est important de noter que les origines de la lombalgie sont multiples. Ainsi, parmi les plus fréquentes, on retrouve :
Les troubles mécaniques :
Hernie discale.
Arthrose lombaire.
Contractures musculaires.
Déformations de la colonne (scoliose, hyperlordose).
Les facteurs liés au mode de vie :
Mauvaise posture prolongée.
Sédentarité.
Port de charges lourdes.
Surpoids et obésité.
Les causes traumatiques de la lumbago une douleur lombaire
Chutes.
Accidents de la route.
Efforts physiques brusques.
Les causes plus rares mais graves :
Infections vertébrales.
Métastases osseuses.
Maladies inflammatoires chroniques (spondylarthrite ankylosante).
Ainsi, bien qu’une grande partie des lombalgies soient bénignes, certaines nécessitent une prise en charge médicale urgente.
Les symptômes associés
Outre la douleur lombaire elle-même, les patients peuvent présenter d’autres signes :
Une raideur au niveau du bas du dos.
Une diminution de la mobilité.
Des douleurs irradiant vers les fesses ou les jambes (sciatique).
Dans les cas plus sévères : troubles urinaires ou neurologiques, pouvant traduire une compression nerveuse importante.
Complications possibles
Lorsque la lombalgie n’est pas traitée correctement, elle peut évoluer vers la chronicité. Cela entraîne alors :
Une altération de la qualité de vie.
Une limitation des activités quotidiennes et professionnelles.
Un risque accru de dépression en raison de la douleur persistante.
Il devient donc essentiel de prévenir et de traiter efficacement cette affection dès ses premiers signes.
Les options de traitement lumbago plantes contre les douleurs lombaire
Le traitement de la lombalgie dépend de sa cause et de sa gravité. Toutefois, on distingue généralement plusieurs approches :
Les mesures de première intention :
Repos relatif (éviter l’alitement prolongé).
Application de chaleur locale.
Analgésiques et anti-inflammatoires.
La kinésithérapie et les exercices :
Étirements et renforcement musculaire.
Rééducation posturale.
Techniques de physiothérapie (électrothérapie, massages).
Les approches complémentaires :
Ostéopathie.
Acupuncture.
Yoga ou Pilates pour renforcer le tronc.
Les cas plus sévères :
Infiltrations cortisoniques.
Chirurgie (en cas de hernie discale sévère ou de compression nerveuse importante). Contacter nous pour plus d'assistante
-
Hémorroïdes et saignements complication et solution bio
- Par narso10
- Le 19/09/2025
Les hémorroïdes sont des veines enflées dans et autour de l’anus et du rectum, pouvant entraîner des saignements, généralement sous forme de petites quantités de sang rouge vif avec les selles. Ces saignements sont un symptôme fréquent lors d'une crise hémorroïdaire. Bien que les hémorroïdes soient souvent sans gravité, elles peuvent causer une gêne et nécessitent parfois un traitement. Si vous constatez des saignements, il est conseillé de consulter un professionnel de santé pour évaluer la situation et envisager un traitement approprié.
Prière nous joindre , Contacter nous , ou appéler le direct +002290162191623Des hémorroïdes qui saignent : cela se traite
Heureusement, une hémorroïde qui saigne n'est pas une maladie ! C'est un trouble au niveau de l'anus et du rectum tout à fait courant.
Des pommades ou de la creme anti-hemorroides pourront être appliquées, bien que cela ne soit guère confortable, sans parler d'une intervention chirurgicale (une operation des hemorroides ne doit être envisagée qu'en dernier recours, avec des taux de réussite variables…).
On peut au contraire se tourner vers des méthodes plus naturelles, douces et sans douleurs. C'est le but du traitement Hemapro : permettre de guérir les crises et prévenir les risques de récidives.
Nous vous proposons un remède radical contre les hémorroides ; cliquez sur remède radical
Quels sont les symptômes des hémorroïdes ?
Les symptômes de la maladie hémorroïdaire sont variables selon les personnes et selon la localisation des hémorroïdes. Ils peuvent survenir soit sous forme de crise hémorroïdaire aiguë, soit de façon continue. La crise hémorroïdaire se manifeste par de vives douleurs, des saignements plus ou moins visibles, éventuellement la sortie hors de l’anus des hémorroïdes internes. Elle peut se compliquer de thrombose hémorroïdaire.
Les douleurs de la crise hémorroïdaire
Les crises d’hémorroïdes externes se traduisent par l’apparition d’une petite boule juste au bord de l’anus, de la même couleur que la peau. La formation de ce caillot occasionne souvent de vives douleurs, car la paroi de l’anus, très irriguée et innervée, est extrêmement sensible. Les crises d’hémorroïdes internes ne sont habituellement pas douloureuses.
Les saignements lors des hémorroïdes
Les hémorroïdes étant des vaisseaux sanguins très superficiels, les saignements sont fréquents. Ceux dus aux hémorroïdes internes sont plutôt des saignements discrets, généralement visibles uniquement sur le papier toilette, pendant ou après les selles.
Le prolapsus hémorroïdaire
Lorsque les hémorroïdes internes sont très dilatées, elles peuvent apparaître hors de l’anus, notamment lors des poussées : c’est le prolapsus hémorroïdaire. Il peut provoquer des irritations, des démangeaisons ou une envie fréquente d’aller à la selle, sans résultat.
Prière nous joindre , Contacter nous , ou appéler le direct +002290162191623Quelles sont les complications éventuelles des hémorroïdes ?
Les crises d’hémorroïdes disparaissent habituellement en quelques jours. Elles ont tendance à réapparaître. Elles entraînent des saignements. S’ils sont abondants et répétés, ils peuvent entraîner une anémie. La véritable complication est l’étranglement des hémorroïdes à l’anus, source de douleurs vives et durables, notamment si un caillot se forme (thrombose hémorroïdaire).
Sang rouge et sang noir
Le sang dans les selles peut se présenter sous deux formes. S’il est visible et rouge, l’affection qui touche le patient est nécessairement située dans le bas des intestins. En effet, si le sang est noir, cela signifie qu’il a été « digéré » et transformé. Il provient donc d’une situation en amont du tube digestif. Le sang noir est rarement visible parmi les selles, sauf lorsqu’une hémorragie importante provoque l’apparition de selles noires et particulièrement malodorantes. Habituellement, seul un test en laboratoire d’analyses peut le mettre en évidence avec certitude.



 Anglais
Anglais
 Espagnol
Espagnol
 Français
Français